JC Ruggirello
Exposition personnelle 2013from January 5 to March 12 - 2013
print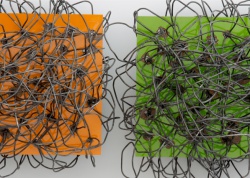 J’aimerais découvrir un procédé tel que si j’avais envie qu’il pleuve,il se mette aussitôt à pleuvoir. John Coltrane, 1962
J’aimerais découvrir un procédé tel que si j’avais envie qu’il pleuve,il se mette aussitôt à pleuvoir. John Coltrane, 1962
Autant
la dévoiler d’emblée à ceux qui entrent dans l’exposition de JC
Ruggirello : l’expérience à l’origine de son travail est sonore. Il y a
tant de choses à percevoir dans l’énigme du présent assemblage de pièces
que le silence, qui couve et contient chaque élément de son travail
jusqu’à son élaboration finale, en sera presque la seule composante
imperceptible ici. Cette mèche une fois vendue, reste à balayer le
spectre unique parcouru par toutes ses propositions.
Le film
seul pourra nous retenir pendant une durée in(dé)finie. On cède à la
fascination à la vue du soleil qui n’en finit, et n’en finira jamais, de
descendre vers une terre ou une mer balisées par l’homme. Plages
habitées de cris ou plantées de poteaux, jetées sentimentales, ponts
périurbains, maillages industriels, rails et routes, chemins et dunes,
nuées vues d’avion ; réunies pour l’éternité par le glissement velouté
d’une séquence dans l’autre, ces territoires ajointés du couchant nous
réconcilient définitivement avec la condition humaine - dont elles font
l’expérience magiquement étirée d’une contemplation sans chute, donc
sans drame. Retiré par définition de ce que l’on perçoit, qui n’est
jamais qu’une suite d’images, on ne désire finalement qu’y entrer pour
n’en plus sortir, tant ce voyage qui se fait pour nous, à notre place,
apaise sans même menacer d’émouvoir.
C’est qu’il est froid, en
fait, le point de vue de celui qui a ourdi ce complot du factice. Toutes
ces images, attachées les unes aux autres selon un mode proche de la
versification, appartiennent bel et bien à tout le monde, parce qu’elles
n’ont pas d’auteur. Prélevées dans l’océan de données virtuelles du
réseau mondial, accouplées comme des cobayes à des sons tout aussi
dépourvus d’origine, elles fabriquent de toutes pièces le réel idéal de
chacun et nous jettent au visage le cliché de nos propres rêves. Nous
sommes, décidément, bien convenus. Nous y avons cru.
Proprement
remis en place par cette méchante opération de séduction – la mariée
était trop belle – il nous reste à saisir ce que recèle peut-être
l’opacité de la plupart des autres pièces. Au fond, brillant pour
brillant, impeccable pour lavable, pelliculé pour plastique, l’ensemble
du travail articulé ici ne démontre, scientifiquement, que les
propriétés de la matière, pour peu qu’on la choisisse bien lisse. Il ne
s’agit vraiment, mais alors vraiment pas, de la faire réfléchir. Pour
l’en empêcher, au contraire, JC Ruggirello l’a torturée selon un mode
suffisamment sophistiqué pour paraître brutal. En trouant
irrégulièrement la jolie géométrie colorée de cubes, carrés, rectangles
en formica, il impose à la conscience l’idée d’impacts de balles, que
les titres à consonance mafieuse viennent confirmer, alors que les
occupants opportunistes de ces pertuis sont de gentils branchages - ou
d’inoffensifs fils de fer dont pas un n’est raide ou saillant au point
de pouvoir blesser.
Bon. Que font les trajectoires de ces matériaux
antagonistes dans l’ordre méticuleux de chaque monochrome ? Les unes
jaillissent. Poussent, même ; le bois, qui n’est pas mort, suintant
encore de résine odorante. Les autres reviennent sur elles-mêmes,
traversent et retraversent au point qu’on n’a pas la queue d’une idée de
l’emplacement de leur début, ou de leur fin. De la croissance au
gribouillis, ces traits se déclarent infinis et rien ne peut les
démentir. Le support coloré n’est là que pour servir le brouillage de sa
propre perception, le regard se trouble là où l’esprit se perd en
conjectures. C’est là qu’il faut revenir à l’expérience première du son,
qui conditionne les manipulations presque sadiques de JC Ruggirello
depuis leur début.
Le son nous environne, nous traverse et nous
constitue sans que nous en ayons conscience. Rien n’impose que ce
phénomène, le plus souvent enfermé dans la consommation du plaisir
musical, nous intrigue. Or le son est comme la température, rien ne lui
échappe, son règne s’étend jusqu’au silence dont il occupe le fond
inouï. Le son est vibratile, tournoyant, complexe. Dans un film c’est
lui qui donne la profondeur à l’image, dans la vie c’est lui qui,
indiquant à chaque instant la distance entre les choses, constitue la
perspective du réel.
C’est lui que JC Ruggirello a pisté voilà
déjà longtemps et persiste à vouloir attraper et dessiner, à travers
tous les moyens du visible. La pièce White noise, par exemple, tire son
nom du « bruit blanc » qu’on obtient en nivelant la densité de toutes
les fréquences, et qui sert de fond, de souffle, voire d’atténuateur
acoustique. On le trouve dans un autre medium cher à JC Ruggirello,
l’effet de neige des écrans de télévision en panne. Chez lui, la
matérialité du son conditionne les formes. Ainsi du lacis impénétrable
de bande transparente colorée d’abstractions posée là, sur un socle.
Sculpture trop légère pour incarner correctement ce statut, dessin
précis d’intentions harmoniques, cette embrouille transparente est comme
son auteur, elle dit tout de sa composition et personne ne sait d’où
elle vient.
Et puis, pour la bonne bouche, l’explication
définitive du travail présenté ici est dans la révérence de l’artiste
pour la forme la plus aboutie qui existe au monde, et qu’on reconnaîtra
ça et là dans les perturbations visuelles qu’il a patiemment mises au
point : la barbapapa. Expérience scientifique à la portée de tous, la
barbapapa traverse tous les états de la matière jusqu’à sa dissolution
dans la digestion humaine. L’art, pour peu qu’on accepte de perdre le
nord à son examen, ne fait pas grand-chose d’autre.
L’autonomie
de la pensée est vaine puisqu’il lui faudra toujours, si elle veut
subsister comme pensée, faire retour aux choses dont elle vient, dans
cette unité de la physis. Roger Munier, La pensée totale, 1961
Éléonore Marie, janvier 2013